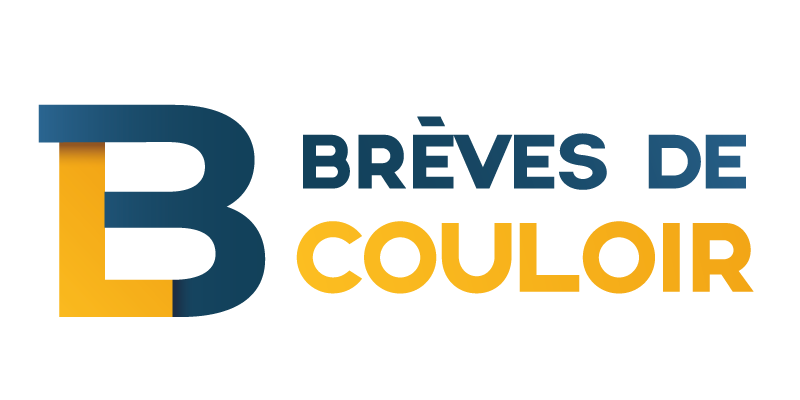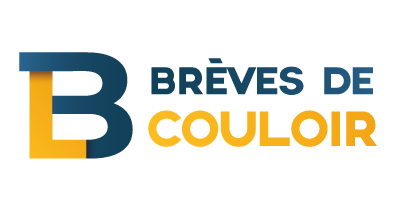Certains dictionnaires enregistrent « designeuse », d’autres l’ignorent entièrement. Au Québec, l’usage institutionnel penche pour « designer » au féminin, sans variation. Pourtant, l’Académie française n’a jamais tranché officiellement ce cas. Dans les offres d’emploi, les deux formes coexistent, parfois dans la même annonce.Le mot, d’origine anglaise, résiste aux mécanismes habituels de féminisation du français. Ce flottement alimente débats et hésitations, aussi bien dans l’administration que dans les milieux professionnels.
Pourquoi le féminin de « designer » suscite-t-il autant de débats ?
Le sort du mot « designer » soulève toujours des crispations. Ce terme importé, venu tout droit de l’anglais sans passer par la case féminisation classique, fait exploser les codes habituels. Le français, confronté à la nécessité de rendre visibles les femmes dans la sphère professionnelle, se confronte ici à un mot étranger qui défie la règle. L’Académie française se tait, le Québec adopte le mot invariable, et dans les univers pros, chacun bricole sa solution.
Dans les couloirs, sur les forums ou les offres d’emploi, chaque acteur y va de son improvisation. Certains gardent la forme neutre, peu engageante mais simple, d’autres inventent « designeuse », d’autres insistent sur « designer femme ». Les dictionnaires avancent avec prudence, et la correction automatique calque, sans naturel, ce flou général. La tension est palpable entre la volonté d’ouvrir la langue, de représenter les femmes, et l’attachement aux habitudes grammaticales.
Quelques éléments-clés pour situer le débat :
- Depuis les années 1980, la féminisation des noms de métiers transforme la norme, mais sans régler chaque cas particulier.
- En 2019, le rapport de l’Académie française sur les titres professionnels reste muet face aux anglicismes comme « designer ».
- Au Québec, la tendance officielle est de ne pas modifier les emprunts linguistiques d’origine anglaise, du moins à ce stade.
Ce tumulte autour du féminin de « designer » ne concerne pas que la grammaire : le choix du mot envoie un signal sur la place des femmes, la manière dont la langue évolue, ou résiste, à l’air du temps. Et derrière la question de la forme, c’est l’accès à la reconnaissance et à la légitimité qui se joue à chaque intitulé.
Panorama des règles de féminisation des métiers en français
La féminisation des titres pros ne date pas d’hier. Le chantier s’est ouvert à la faveur de luttes sociales et politiques : transformer la langue, c’est aussi infléchir ce qu’elle rend possible en société. Les débats sur le féminin des professions s’enchevêtrent entre recommandations normatives et attentes de représentativité.
Quelques règles structurent la pratique actuelle. Quand la structure du mot permet, la féminisation passe le plus souvent par -e, -eure, -trice ou -ienne : « auteure », « architecte », « ingénieure », « professeure ». Mais pour des noms sans modèle féminin hérité, on patine : au Québec, la forme reste invariable ; ailleurs, certains essaient d’en créer une.
On peut résumer les grandes tendances en quelques points :
- La rectification de l’orthographe de 1990 a mis en lumière des féminins auparavant marginaux ou contestés.
- Les usages typographiques privilégient l’accord du genre dans les titres et fonctions.
- Pour les mots venus d’ailleurs, dictionnaires et instances officielles avancent sur la pointe des pieds, hésitant à généraliser des féminins qui sonnent fabriqués.
Mais féminiser, ce n’est pas seulement s’aligner sur des manuels. C’est nommer, c’est faire exister. Pour certains métiers, le féminin s’est imposé ; pour d’autres, le terrain reste incertain. La langue, elle, suit son propre rythme, entre inertie et tentatives d’alignement avec l’actualité sociale.
Designer, designeuse ou designer femme : quelles formes sont correctes et reconnues ?
Impossible de ne pas constater l’embarras. Le mot designer échappe à la mécanique habituelle. Son masculin générique domine largement, dans la presse comme dans la vie courante. Toutefois, la revendication d’une féminisation des métiers avance de plus en plus dans les domaines créatifs, où les femmes prennent leur place.
Certains essaient le suffixe « -euse » : « designeuse », à la manière de « programmeuse » ou « rédactrice ». Cette création demeure réservée à quelques initiées ou militantes, rarement reprise dans les écrits institutionnels. Au Québec, la forme existe mais reste minoritaire, l’option invariable étant souvent maintenue. À la clé, chaque choix pose la question de la clarté, de la lisibilité et du parti pris linguistique.
Pour mieux comprendre ce qui se pratique, voici les options qu’on retrouve le plus :
- Designer : partout et pour tous, hommes et femmes. C’est l’usage le plus répandu, y compris pour désigner une professionnelle.
- Designeuse : populaire dans certains milieux, peu appréciée ailleurs pour son côté artificiel ou décalé.
- Designer femme : souvent rencontrée dans les annonces d’emploi, mais la tournure paraît lourde et maladroite.
Dans tous les cas, nommer, c’est reconnaître. Adopter l’une ou l’autre de ces formes, c’est révéler une posture, ouverture au changement, attachement à la tradition, ou recherche d’équilibre. Les institutions temporisent, les dictionnaires observent, mais sur le terrain, les usages évoluent à vue.
Conseils pratiques pour employer le bon féminin selon le contexte
Naviguer entre les formes pour parler d’une designer demande d’adapter son choix au contexte et au type de texte. Pour les documents officiels ou administratifs, le masculin générique reste d’usage, même si la réflexion sur la féminisation des métiers prend de l’ampleur. Certaines organisations qui s’investissent dans l’écriture égalitaire proposent la double forme : « designer ou designeuse », pour mettre en lumière la diversité professionnelle sans bouleverser la lecture.
Adaptez la forme à la situation
Selon le secteur ou le public, il peut être pertinent de :
- Dans des milieux sensibilisés à la langue inclusive, on privilégiera parfois « designeuse » ou « designer (femme) ». Voir le point médian (designer·euse) dans certains collectifs, même si cette écriture reste marginale hors des cercles militants.
- Pour souligner un parcours, il est possible d’accorder l’adjectif : « une designer reconnue ». Ainsi, on marque le féminin sans forcer l’intitulé du métier.
- Dans le domaine académique ou scientifique, on calque généralement la pratique du texte : si « designer » est invariable dans l’ensemble, le rester garde la cohérence du propos.
Les recommandations en matière d’écriture soucieuse de l’équilibre des genres s’orientent vers la double flexion dans les titres et l’accord des adjectifs au féminin pour rendre visible la place des femmes. Le souci de compréhension reste prioritaire, particulièrement pour des contenus qui s’adressent à tous.
Un réflexe judicieux : sonder l’avis des principales intéressées, et harmoniser les choix linguistiques dans tout le document. Détail après détail, la visibilité des femmes se construit aussi dans ces choix de mots, témoins du changement.
En définitive, chaque terme employé pour désigner une professionnelle du design porte en lui la trace d’un compromis, d’un élan, ou d’une résistance. Forcer le français n’est pas toujours payant ; mais choisir en conscience, c’est déjà accompagner le mouvement. La langue évolue, elle aussi, parfois à petits pas, mais sans retour en arrière.